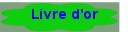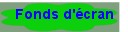|
| |
| | |
Abbaye
Notre-Dame des
Anges
| |
|
| |
|
Coordonnées géographiques :
48°35'46.38"N
4°34'10.64"W
| | | |
|
| |
|
"Descendant du bourc parrochial pour se rendre au port d'Aber-Grac'h,
vous ne pouvez qu'admirer en passant la belle église et le dévôt monastère de
Notre-Dame des Anges, de l'Ordre des Pères Cordeliers observantins"
(Albert LE GRAND
- "Vie des Saints de la Bretagne Armorique")
| |
|
| |
|
| |
|
Vues générales de l'édifice (cartes
postales anciennes) :
| |
|
| |
|
| |
|
1453 Une communauté de moines, les
"Cordeliers", qui vivaient à l'île Vierge finit par désirer un site moins
inhospitalier et s'installe à la Baie des Anges.
1507 Un
don du seigneur Tanguy du Chastelet sa femme Marie du Juch permet l'édification d'un couvent
agréable, consacré à Notre-Dame des Anges. Le 1er dimanche de mai ("dimanche
4ième après Pasques
"), fondation du
Couvent Notre-Dame des Anges, de l'ordre de Saint
François. Inauguration par Messire de Kermavan , évêque du
Léon.
La concession du terrain fut faite par
la famille de Kermavan. les frais de la construction furent donc
assurés par Tanguy du Chastel, dont les armes sont gravées sur la porte
Sud de la chapelle et sur les vestiges du calvaire.
Les bienfaiteurs du couvent ont inscrit
leurs noms sur quelques piliers du cloître :
-
Jehan Le Bonno
-
G. Billouart et Jehene
Taigne
-
Le Peuch
-
Guillouvi (?)
-
Prigent
-
Lorans Paris, marchand de Rennes,
financier et miseur
1582 date sur l'arcade
Sud
1583
Les "Récollets", à la règle plus austère, remplacent
les "Cordeliers ". Dans l'entrée se trouve un
figuier, signe de l'Ordre de St François, présent dans tous les monastères
fondés par cet Ordre. Le figuier remplace parfois
l'olivier.
| | | |
|
| |
| | |
1689 Les religieux sont
au nombre de 18 (la communauté religieuse n'a jamais été
nombreuse)
1692 Un incendie provoque de grands
dommages
1768 Il ne reste que 8
moines, entourés de domestiques (jardiniers, cuisiniers, couturiers, valets...)
et de laïcs venant effectuer une retraite ou un séjour de santé.
14 juillet 1791 :
décret d'expulsion des religieux (qui étaient au nombre de trois). Les quelques
biens qui subsistent dans les
locaux sont extrêmement modestes, hormis le contenu de la bibliothèque.
23 juillet 1792
Vente de l'édifice comme "Bien National" à Josep Xavier
Vatrain, premier propriétaire laïc, pour la somme de 15 110 livres. Cet
ingénieur des bâtiments civils de Brest se hâta de prendre
possession notamment des 1200 volumes de la bibliothèque...
1800 Achat de
l'abbaye par Monsieur Keratry
1800 Achat de
l'abbaye par Messieurs Deshayes et Mignard
| |
|
| |
|
1830 Eglise transformée en
magasin
1900 Eglise toujours magasin et décharge.
Les logis sont hôtel pour touristes.
1934 J.P PINCHON
commence à séjourner deux mois par an à l'abbaye et la dépeint dans plusieurs
illustrations et tableaux.
1962
Elargissement de la route littorale (seule une charette pouvait passer
auparavant). Expropriation pour une bande de terrain et déplacement du mur
d'enceinte.
2002 Protection
au titre des monuments historiques : l'ensemble des bâtiments conventuels en
totalité y compris la fontaine, les sols des deux cours, des jardins et vergers,
du cimetière et les murs de clôture. (cad. C 887, 888, 889, 1, 2). Inscription
par arrêté du 11 février 2002.
A noter que les
propriétaires actuels du site ont dédié un
site
internet à l'abbaye, on s'y réfèrera
pour plus de détails quant à l'histoire et l'organisation des différentes
entités de l'abbaye.
| |
|
| |
|
L'abbaye représentée par
J.P PINCHON :
Joseph Porphyre PINCHON
prit l'habitude, dés 1934, de séjourner deux mois par an à
l'hôtellerie des Anges, dans "l'ancien pigeonnier". L'infatigable artiste
illustrateur, père de Bécassine, dessina à plusieurs reprises l'abbaye. Les
documents originaux ont disparu. Un commissaire priseur est venu chercher tout
le mobilier et les effets de l'artiste le 23 novembre 1983. Le
tout a sans doute été vendu à Paris et doit figurer dans des collections
privées.
Voici un aperçu du genre de documents
qui a disparu :
| | | |
|
| |
|
| |
|
Ces illustrations
sont extrêmement précieuses car les lieux ont beaucoup changé
depuis.
Principales remarques à la vue de ces
croquis :
-
le calvaire principal, dont seul
subsiste le croisillon, était près de l'entrée de
l'abbaye (menu illustré de 1939), ou bien au centre de l'actuelle parcelle
triangulaire, ancien cimetière des moines (tableau disparu).
-
un second calvaire, fort haut, se
dressait dans la cour où se trouve aujourd'hui le cadran
solaire.
-
le clocheton de l'abbatiale est
représenté deux fois de façon sensiblement identique. L'information de son
aspect est peut-être fiable.
-
Abbatiale représentée en bon état en
1939, en ruine en 1942, avec disparition des deux calvaires. Est-ce
allégorique (Occupation) ou bien le reflet de dégâts réellement survenus
entre-temps ?
Il faut faire appel aux souvenirs des anciens
de la commune !
| |
|
| |
|
L'abbaye, telle que représentée dans les cadastres
successifs :
| |
|
| |
|
| |
|
Les différentes armoiries visibles dans l'abbaye
: (cliquer sur l'image pour le
descriptif)
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
Gravure de navire marchand : ex-votto
des marchands qui ont toujours abondé en l'aber
Wrac'h
| |
|
| |
|
Ex-votto figurant un navire
offert à Notre-Dame des Anges en 1544 par les marchands de
Penmarc'h.
Témoignage d'une époque où les bretons armaient une flotte
marchande considérable. En kersantite
.
| | | | |
|
| |
|
Vues de l'abbaye, lors de l'inventaire du patrimoine en
1979 :
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
Le cloître (bâtiment
A) :
| |
|
| |
| | |
D'autres piliers du
cloîtres se trouvent à l'entrée Nord, et d'autres enfin ont été utilisé pour les
accès à la plage de l'autre côté de la route.
| |
|
| |
|
Le pigeonnier (bâtiment
B) :
| |
|
| |
|
| |
|
Un étrange blason incrusté
dans le mur
d'enceinte :
| |
|
| | 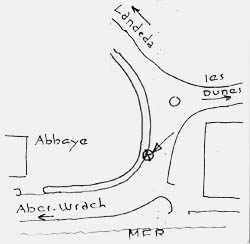 | (emplacement exact) |
| |
|
| |
|
L'abbaye autrefois sujet
de cartes postales typiques :
(collection P.
Oulhen)
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
Autres cartes postales anciennes :
(collection Jo
Cariou)
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
L'abbaye aujourd'hui : (août
2007)
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
Enfeu réutilisé (provient de la chapelle) :
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
(in "Les cahiers de l'Iroise"
1970)
| |
|
| |